PRÉSENTER ET COMMENTER UNE ŒUVRE PICTURALE
Présenter et commenter une œuvre
picturale lors du voyage de Florence
I.
PRÉSENTATION DE L’OEUVRE
1. Le genre. :
·
Religieux (vierges, crucifixion, cène, conversation
sacrée quand plusieurs saints et saintes entourent une vierge…)
·
Historique (la bataille de San Romano aux Offices)
·
Mythologique (le Printemps de Botticelli)
·
Allégorique (la justice de Botticelli)
·
Le portrait (Frederico de Montefletre par Piero della Francesca)
·
Le paysage est rare pendant
la Renaissance, le genre apparaît surtout dans le nord de l’Europe au XVIe s
·
La scène de genre (marine, paysans, intérieurs) surtout à
partir du XVIIe siècle
2. Le titre de l’œuvre.
Les titres peuvent varier suivant les
sources, au Moyen Age et à la Renaissance l’artiste peint souvent un sujet connu
de tous : une annonciation, une maesta, un cortège des mages. Les
historiens de l’art ont pu préciser avec le lieu où était détenue l’œuvre par
exemple la Maesta Ognissanti car
peinte pour cette église. Seuls les livres d’histoire de l’art permettent de
trouver ces précisions d’appellation.
3. La datation
Ne pas s’étonner du fait que plusieurs
dates peuvent être mentionnées suivant les
livres pour une même œuvre. Cela reflète les incertitudes de datation et les
débats savants entre historiens de l’art. Pour cette raison on dira souvent : «
vers … »
4. L’artiste
- Son nom
précis : à la Renaissance il peut y avoir des surnoms. Ainsi Fra Angelico
est un surnom attribué à Guido di Pietro. Masaccio a pour nom Tommaso di Giovanni Cassa. Il faut donc ne pas se
laisser désorienter.
- Préciser les dates du peintre et faire sa biographie
sans la recopier ! Pour cela sélectionner 3/4/5 dates qui correspondent à
des moments importants de sa vie (souvent il s’agit des villes où il a résidé)
et s’obliger à construire la biographie simplifiée à partir de là.
5. Le contexte de réalisation
A la Renaissance il s’agit souvent d’identifier
qui a commandé l’œuvre.
À quel lieu était-elle destinée ? (si
elle est aujourd’hui dans un musée)
Dans quel lieu se trouve-t-on ? ex. Il
est important de réaliser que la fresque de Sienne Le bon et le mauvais gouvernement est dans une salle de
conseil : l’œuvre est un exemple, un programme politique pour les élus qui
y siègent.
6. La technique utilisée
La
fresque
sur un mur ou peinture « a fresco » sur un enduit humide.
Si on a retrouvé les traits de construction
préparant une fresque qui a été décollée (c’est une technique courante pour
préserver une œuvre menacée) on peut voir la sinope ou dessin préparatoire
tracé au pinceau en rouge généralement qui a subsisté sou l’œuvre.
Enluminure de manuscrit.
La technique est à préciser : ainsi un
tableau de chevalet pourra être peint à la détrempe
ou « a tempera » jusqu’au XVe siècle mais progressivement la peinture à l’huile coexiste avec l’emploi de
pigments à l’œuf.
Pour des œuvres religieuses on pourra aussi
préciser s’il s’agit d’un polyptique (diptyque ou triptyque)
On indiquera aussi le support utilisé :
bois ou toile à partir du XVIe s. parchemin pour les manuscrits.
II. Description ORDONNÉE de l’œuvre
1. Le sujet
Ne pas confondre le genre ex : genre
mythologique (voir plus haut) et le sujet du tableau, ex : la naissance de
Vénus.
2. Identifier les personnages avec précision
Dans le cas de grandes compositions ce n’est
pas toujours facile. Ainsi Le
couronnement de la Vierge de Fran Angelico comporte une foule de saints et
on se contentera de savoir identifier les plus importants. L’aide des ouvrages
d’art est indispensable : avec l’habitude on sait immédiatement reconnaître
un Saint Jean-Baptiste d’un Saint jean l’Evangéliste, une Marie-Madeleine d’une
Vierg , un Saint Paul d’un Saint Pierre mais avant d’avoir cet
«œil » il faut chercher dans les livres !
Les attributs des personnages vous guident
facilement : instrument du martyre : Saint Laurent avec son grill,
Sainte Catherine de Sienne avec une roue percée de pointes, l’épée de Saint
Paul, la chevelure somptueuse de Marie-Madeleine mais elle partage cet attribut
avec Sainte Marie l’égyptienne !
Il faut être capable d’identifier la
scène : ex. Qu’est-ce qu’une nativité ? Quel évangile en parle ?
Qui est Vénus ? Mercure psychopompe ?
Des livres indispensables :
- Une Bible
- Lucia Impelluso, Dieux et héros de l’Antiquité ,
collection guide des arts , Hazan, 2003.
- Un dictionnaire
biblique : Jean Pierre Hammel et Muriel Ladrière, La culture occidentale dans ses racines religieuses, Hatier, 1991
Ou Gaston Duchet-Suchaux, Michel
Pastoureau, La Bible et les Saints,
Flammarion, 1994.
S’il
s’agit d’un portrait
le travail sera de présenter le personnage représenté. Et d’en proposer une
courte biographie
3. La composition : la façon dont le peintre a
organisé son sujet
À la Renaissance, les artistes cherchent à
inscrire leur sujet dans des figures géométriques, dans des lignes de
construction plus ou moins complexes qu’il faut repérer.
S’il y a une représentation en perspective,
identifier les points de fuite c’est
à dire le point imaginaire où convergent toutes les lignes du tableau (pas les
verticales qui sauf effet de contre plongée sont parallèles au bord de
l’œuvre). Il peut y avoir plusieurs points de fuite. C’est plus facile
lorsqu’il y a une architecture
(intérieur d’une « annonciation » par exemple)
4. Les différents plans de la composition
- Le
lieu de la scène représentée (intérieur, extérieur)
Ex. un décor naturel : Masaccio et la scène du tribut,
Un décor inspiré de
l’antiquité et le cortège des mages
de Ghirlandaio,
Une ville médiévale
dans la fresque du bon gouvernement à
Sienne.
- L’architecture où s’inscrit le
sujet doit être décrite avec précision. On utilise le même vocabulaire que pour un monument réel, surtout
à la Renaissance où les formes inspirées de l’Antiquité doivent être nommées
avec précision: fronton, chapiteau ionique, corinthien… arcs brisés, en plein
cintre.
5. La couleur.
- Les
fonds :
avant la Renaissance, l’or est utilisé pour suggérer « l’espace du
paradis »
L’or peut servir aussi pour imiter des
ornements des tissus précieux. Cette habitude se perd au cours de la Renaissance.
- La
palette
peut être chaude : par exemple chez des peintres comme Lorenzo Monaco ou
Fra Angelico qui sont aussi des miniaturistes, on repérera les bleus à base de
Lapis lazulli. Chez Masaccio ce sont des couleurs plus froides.
III.
L’ANALYSE DE L’ŒUVRE
1. Le style du peintre
Quelles sont les influences qu’on peut
voir ?
Les peintres italiens du XIIIe
siècle sont influencés par les Byzantins et leurs icônes.
Fra
Angelico a une formation de miniaturiste : cela aide à comprendre son goût
pour les couleurs vives et fraîches. Botticelli a d’abord été un orfèvre et un
graveur : cela se voit quand on observe l’importance du trait dessiné dans
ses œuvres…
C’est la biographie qui fournit ces
renseignements.
Ici on peut dire à quel mouvement, à quelle
école, les historiens de l’art le rattachent (les livres vous fournissent
l’indication en général).
2. Quelle est l’attitude des
personnages ? Quels sentiments expriment-ils ?
- Observer les gestes, notamment les mains, le mouvement des corps souligné
par les drapés : surprise, effroi, acceptation de la volonté divine pour les
Vierges des annonciations, piété pour les rois mages qui se prosternent devant
l’enfant, brutalité des soldats qui assassinent dans les massacres des
innocents
Il n’y pas de règle méthodologique. Les cas
sont infinis. Un seul principe : regarder l’œuvre et chercher le mot
juste.
- Les
expressions : Beaucoup de saints et saintes sont représentés de façon
hiératiques chez les peintres d’avant la Renaissance. Pour les peintres de la
Renaissance, repérer ce qui les humanise, notamment l’expression du visage.
- Qu’est
ce qui rend la scène dramatique, intimiste, solennelle ? Penser à
l’éclairage : d’où vient- il ? Est- il fort ou faible ?
- Le
mouvement :
comment l’artiste suggère-t-il un mouvement ? Rôle des drapés, des
cortèges, des lances dans une bataille
3. Les symboles, les interprétations
C’est vraiment une chose par laquelle il
faut finir et non pas commencer !
- Il y a des symboles connus : par exemple la crèche de la nativité qui est un
temple antique en ruine pour suggérer la disparition du monde païen. Il faut
toujours être prudent se méfier des guides touristiques et aller vérifier dans
les livres d’histoire de l’art qui proposent des interprétations ;
- Les tableaux qui semblent complexes se
lisent bien si on connaît la référence mythologique (c’est le cas du Printemps de Botticelli qui est
l’illustration d’un poème d’Ovide) ou le
texte biblique.
Surtout ne pas se lancer dans une
interprétation symbolique sans avoir vérifié ce que disent les historiens d’art!
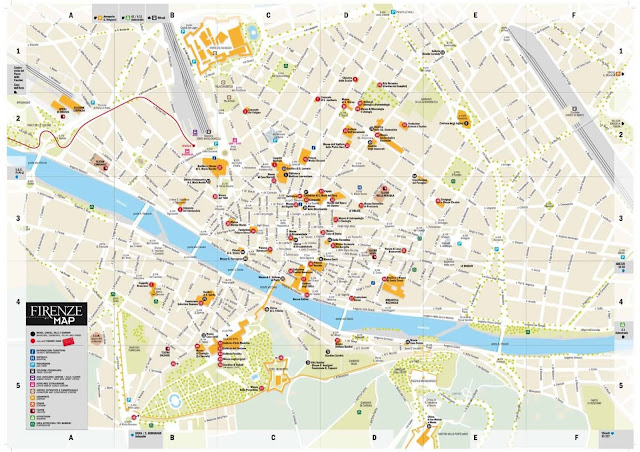
Commentaires
Enregistrer un commentaire